- ACCUEIL -
COLEOPTERES -
LEPIDOPTERES -
AUTRES
-VIDEOS - HISTORIETTES
- NEWS - LIENS
- WANTED
! - MAILS
d'OR
-
-

-
- la BRAHMÉIDE
de HEARSEY (Brahmaea hearseyi) !
- (Lépidoptère
Brahmaeidae)
-
- (page 2 sur
4)
-
-
- - pour quitter les
agrandissements faire "page précédente" dans votre
navigateur -
-
-
- Une fois n'est pas coutume
!
- Cette "page entomo" est en effet
très exceptionnelle,
- car c'est la seule concernant
une espèce dite "exotique".
-
- Intro !
-
 Avec
Jean Ferrat la chanson a eu ses "belles étrangères"
... d'où l'idée de ce "clin d'oeil" à propos
d'une autre belle étrangère !
La transposition est certes osée, et
la notion de beauté présentement subjective, mais
l'originalité de la bête étant par contre
indéniable, il s'en est suivi un élevage "coup de
coeur" ... et le plaisir de vous y convier par le texte et l'image
!
Avec
Jean Ferrat la chanson a eu ses "belles étrangères"
... d'où l'idée de ce "clin d'oeil" à propos
d'une autre belle étrangère !
La transposition est certes osée, et
la notion de beauté présentement subjective, mais
l'originalité de la bête étant par contre
indéniable, il s'en est suivi un élevage "coup de
coeur" ... et le plaisir de vous y convier par le texte et l'image
!-
- Sans oeufs point de chenilles, et encore
moins de papillons. C'est pourquoi je tiens à remercier
l'ami Frank pour son amitié, et sa
générosité, car sans lui cette page entomo
n'existerait pas. J'ajouterais que ce naturaliste et photographe
professionnel hors pair a su passion garder, comme
en témoigne son site.
-
- Présentation
-
- Avant d'entrer dans le vif du sujet,
vous noterez que le nom de Brahmaea est à mon sens
clairement féminin, et cela du seul fait de sa terminaison
latine en "a". En toute logique on doit donc dire LA -ou une-
Brahmaea, et par voie de conséquence LA -ou une-
Brahméide (= Brahmaéide) ... même si l'usage
et le Web en ont semble-t-il décidé
autrement.
-
- Brahmaea hearseyi est un robuste
papillon nocturne pouvant dépasser 15 cm d'envergure.
L'espèce est notamment connue du Cambodge, Laos, Vietnam,
mais aussi de Chine et Thaïlande. Ce papillon relève
de la Famille des Brahmaeidae, caractérisée
par un graphisme alaire très particulier, et une
ornementation tégumentaire non moins originale des
chenilles.
-
- Une grosse vingtaine d'espèces est
répertoriée au niveau mondial, ce qui est fort peu,
et témoigne bien de la spécificité de cette
Famille. Toutes sont asiatiques, ou africaines,
exceptée la "Brahméide
d'Hartig" (Acanthobrahmaea europaea), seule espèce
européenne, comme son nom le laisse entendre.
-
-
- la Belle ! ....
 ...................
................... ... et la Bête !
... et la Bête !
- L'étrange graphisme des ailes, et
son peu banal relief en "trompe-l'oeil", confèrent à
ce curieux papillon une beauté déjà quelque
peu inquiétante (et plus encore tête en bas, comme
ci-dessus à droite ! ) ... mais attendez de voir la
chenille dans ses oeuvres !
-
-



- Les lignes parallèles
répétitives sont typiques de l'ornementation
graphique de la Famille des Brahmaeidae. Ces lignes peuvent
être plus ou moins ondulées, festonnées,
brisées, accentuées, etc...mais elles sont toujours
transversales, nombreuses, rapprochées; et
intéressent une grande partie de la surface alaire.
Présentement vous remarquerez les
curieux "électrocardiogrammes" des ailes
postérieures (à gauche), et l' effet "peau de
tigre" des antérieures (au centre et à
droite).
-
-




- Un mâle "du jour" ( comme
les oeufs frais du même nom ! ), aussi coopérant que
photogénique !
-
-


- .... et "Madame" !
- Vous noterez l'ampleur des
ailes, et ses 16 cm d'envergure
-
-
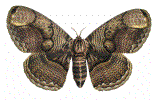

- à gauche:
spécimen de collection (et donc "étalé") ....
une image encore rare sur le web !
- à droite: en
raison de sa relative banalité, le revers des ailes de B.
hearseyi n'est jamais figuré.
- (l'aspect anormalement "pointu"
des ailes antérieures résulte d'un simple artefact
photographique lié à l'angle de prise de
vue)
-
- Pour info !
-
- Sachez que la "Brahméide
d'Hartig", seule espèce européenne je le rappelle, a
été découverte en 1963 par le Conte Federico
Hartig (1900-1980), éminent entomologiste italien.
Même si ce papillon est très étroitement
localisé (Mont Vulture, non loin de Naples), et même
si cela n'enlève rien au mérite de son illustre
découvreur, il est quand même surprenant qu'une
bestiole de cette taille (jusqu'à 75 mm d'envergure), et
d'une telle originalité, ait pu échapper si
longtemps aux entomologistes du cru ... et d'ailleurs ! C'est
d'autant plus vrai que sa cousine hearseyi, la belle asiate de
cette page entomo, a été décrite par Withe en
1862 .... soit un siècle plus tôt !
-
-
- la fameuse Brahméide
d'Hartig.....
 .... (Acanthobrahmaea europaea)
.... (Acanthobrahmaea europaea)
- la seule Brahmaeidae
européenne
- (photo
Wikipédia)
-
- Dimorphisme
sexuel
-
- Le papillon qui pond est à coup sûr une femelle,
et celui qui ne pond pas a de bonnes chances d'être un
mâle ....pourrait-on dire ! Chez la Brahméide
d'Haearsey, les sexes sont en effet quasi identiques ( d'où
cette boutade ! ), étant entendu que les femelles sont
généralement plus grandes, et bien sûr plus
"dodues" eu égard aux oeufs "entreposés".
-
- Quand il est bien marqué, le dimorphisme antennaire
peut constituer un excellent critère, comme chez les
Saturnidae par exemple. Dans ce dernier cas les antennes des
mâles sont fortement pectinées (et donc en forme de
peignes), et celles des femelles au contraire quasi filiformes. Le
problème c'est que les antennes des Brahmaeidae sont
pareillement pectinées chez les 2 sexes ... ce qui les rend
"inutilisables" !
-
- Par contre, et toujours au jeu des différences, vous
noterez que l'ornementation du dessus des extrémités
abdominales de notre Brahméide diffère nettement
selon le sexe. Cela rappelle le dimorphisme graphique observable
chez le Sphinx du laurier rose, et permet surtout d'évoquer
la parenté établie entre les Brahmaeidae, les
Lemoniidae ... et les Sphingidae !
-
-
- mâle !
.....

 .... femelle !
.... femelle !
- comparaison des antennes
....moutons blancs ... et blancs moutons !
-
-


- Détails d'une antenne
(mâle)
- à droite: on
devine l'abondance des "sensilles", autrement dit des soies
sensorielles.
- Sans grand risque de se tromper
il y a sûrement des chimio-réceptrices dans l'air !
-
-
- les mâles !
....

 ...................
................... .
.
 .... les femelles
!
.... les femelles
!
- Vues dorsales des
extrémités abdominales de Brahmaea hearseyi,
- et en médaillons, ce qui
s'observe chez le Sphinx du laurier rose (Daphnis
nerii).
-
- L'oeuf
-
- Les conditions d'élevage sont
souvent fort éloignées de celles observées
dans la nature, notamment pour les espèces dites exotiques,
ce qui peut influer sur le comportement des bestioles. A titre
d'exemple, les oeufs sont souvent pondus sur les parois des cages,
au moins en partie, y compris en présence de la plante
nourricière .... souvent de substitution il est vrai, comme
dans le cas présent !
-
- La ponte de Brahmaea hearseyi se situe
aux alentours de 150 unités, ce qui est important compte
tenu de la grosseur des oeufs, ces derniers outrepassant
légèrement l'extrémité soufrée
d'une allumette. La ponte intervient bien sûr après
l'accouplement, avec dispersion des oeufs, ce qui correspond
certainement à une stratégie défensive, et
peut être à une forme de gestion des ressources
alimentaires disponibles ... "in natura" s'entend !
-
- L'incubation est classiquement fonction
de la température, la bonne moyenne étant de l'ordre
d'une dizaine de jours. Le brunissement du micropyle central
(ci-dessous à gauche) témoigne très
rapidement de la bonne fécondation de l'oeuf, et donc du
début de l'embryogenèse. A terme la segmentation de
la chenillette se perçoit très nettement par
transparence ... puis c'est l'heure "H" du jour "J", la bestiole
pointant un museau souvent longuement dubitatif, avant de franchir
son pas-de-porte.
-
-
-




- de gauche à droite: 1)-
remarquez la taille importante des oeufs, et le brunissement du
"micropyle", propre d'une fécondation réussie. Pour
mémoire je rappelle que le micropyle est la voie de passage
des spermatozoïdes. 2)- dans les 24 à 48 heures
précédant l'éclosion, la segmentation de la
chenillette devient nettement perceptible par transparence.
3 & 4)- la chenillette naissante
marque souvent une pause, nez au vent, avant de s'affranchir de la
protection de l'oeuf.
-
- La chenille
-
- Les plantes nourricières
asiatiques me sont inconnues, mais hors de ses terres, la bestiole
s'accommode aisément du frêne, du lilas, et plus
encore du troène, quasi panacée pour bon nombre
d'espèces de papillons. Dans les conditions optimales de
nourriture et température, le développement est
particulièrement rapide, puisque l'intervalle entre les
mues peut être de l'ordre de 3 à 4 jours pour les
premiers stades larvaires.
-
- Vous noterez qu'il faut se défier
d'une trop grande promiscuité, le cannibalisme
n'étant pas exclu, mais a priori cela vaut surtout quand la
nourriture laisse à désirer en qualité ou
quantité. En d'autres termes il ne faut pas en promettre,
surtout au dernier stade, mais c'est là un impératif
propre à toute chenille digne de ce nom. L'éleveur
débutant a d'ailleurs tôt fait de s'en apercevoir ...
et le confirmé peut encore se faire surprendre tant
certaines espèces sont boulimiques !
-
- Attention également aux
élevages tardifs, et à la tentation de booster le
développement en augmentant la température, car les
risques maladifs (omniprésents en élevage) croissent
pareillement. Un juste milieu est censément
préférable, la bonne "fourchette" se situant de 20
à 25°, avec obtention de la chrysalide en l'espace
d'un mois environ.
-
- Scoli, scolus ... et
coetera !
-
- L'originalité des chenilles de
Brahmaeidae réside dans le port d'excroissances filiformes,
plus ou moins développées, portant le nom de
"scoli". Vous noterez que cette terminologie s'applique à
toutes les formations peu ou prou comparables, telle la "corne"
des chenilles de Sphinx, mais dans ce dernier cas il s'agit d'un
"scolus" .... lequel devient "scoli" au pluriel ! ... CQFD
!
-
- Par-delà leur côté
ornemental ces drôles d'antennes ou de vibrisses ont
à coup sûr des fonctions tactiles (voire
défensives pour certains), et pour s'en convaincre il
suffit d'observer les réactions des bestioles en
élevage, que ce soit par rapport à leur
environnement, leurs congénères ... ou le "personnel
soignant" ! En pareil cas les sensilles afférentes ne sont
jamais bien loin, associées ou non à d'autres
processus sensoriels. Reste à les mettre "officiellement"
en évidence .... si ce n'est déjà fait
!
-
- Sui generis
!
-
- Sauf à avoir l'odorat d'un nain
de jardin, ou le flair d'un chien empaillé, sachez que les
chenilles âgées, et les chrysalides (notamment
à l'émergence du papillon), dégagent une
odeur à la fois très particulière,
très tenace .... et pas vraiment "top". J'ajouterais que
les effluves sont évidemment en rapport avec le nombre des
pensionnaires, et que le moindre relâchement dans
l'entretien des cages en multiplie très vite les
effets.
-
- Bien entendu ce "parfum corporel" a sa
raison d'être, sans doute défensive, d'où le
terme de "répugnatoires" attribué à ces peu
appétissantes odeurs, ainsi qu'aux glandes les
sécrétant. Vous me pardonnerez de n'avoir point
testé, mais si la saveur est à hauteur de l'odeur,
la bestiole peut à coup sûr se pavaner en toute
quiétude sous le nez des prédateurs habituels, tels
les oiseaux par exemple !
-
- .... à
la naissance !
-




-
- la naissance d'une
chenillette de Brahmaea ... et des photos dont je ne suis pas
mécontent !
- Ci-dessous à droite:
vous noterez le déploiement et le grand
développement des "scoli" ci-dessus
explicités.
-




-
-



-
 les
pages entomologiques d' andré
lequet : http://www.insectes-net.fr
les
pages entomologiques d' andré
lequet : http://www.insectes-net.fr
 Avec
Jean Ferrat la chanson a eu ses "belles étrangères"
... d'où l'idée de ce "clin d'oeil" à propos
d'une autre belle étrangère !
La transposition est certes osée, et
la notion de beauté présentement subjective, mais
l'originalité de la bête étant par contre
indéniable, il s'en est suivi un élevage "coup de
coeur" ... et le plaisir de vous y convier par le texte et l'image
!
Avec
Jean Ferrat la chanson a eu ses "belles étrangères"
... d'où l'idée de ce "clin d'oeil" à propos
d'une autre belle étrangère !
La transposition est certes osée, et
la notion de beauté présentement subjective, mais
l'originalité de la bête étant par contre
indéniable, il s'en est suivi un élevage "coup de
coeur" ... et le plaisir de vous y convier par le texte et l'image
! ...................
................... ... et la Bête !
... et la Bête !








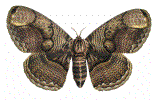

 .... (Acanthobrahmaea europaea)
.... (Acanthobrahmaea europaea)
 .... femelle !
.... femelle !


 ...................
................... .
.
 .... les femelles
!
.... les femelles
!










