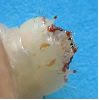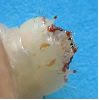- ACCUEIL -
COLEOPTERES -
LEPIDOPTERES -
AUTRES
-VIDEOS - HISTORIETTES
- NEWS - LIENS
- WANTED
! - MAILS
d'OR
-
-

-
- Le GÂTE -
BOIS (Cossus cossus)
!
- (Lépidoptère
Cossidae)
-
- (page
3 sur 3)
-
-
- - pour quitter les
agrandissements faire "page précédente" dans votre
navigateur -
-
-
- Aperçu du
développement larvaire
-
- Dans un premier temps la chenille
évolue sous l'écorce, puis elle
pénètre au cœur du bois pour s'y
développer durant au moins 2 ans. À terme elle
confectionne un cocon, constitué comme vous le verrez de
soie et de particules de bois agglomérées. Elle s'y
transformera en chrysalide, puis bien sûr en papillon, et le
cycle pourra alors recommencer.
-
- Vous noterez l'originalité de la
nymphose chez la chenille de Cossus, puisque qu'au gré de
son humeur (ou de facteurs restant à déterminer!)
deux formules sont possibles. La bestiole peut en effet "coconner
sur le tas", ou opter pour l'abandon de l'arbre nourricier, avec
simple enterrage au terme d'un cheminement à
découvert plus ou moins long, mais toujours rondement
mené ... et risqué !
-


- les oeufs du Cossus étant
petits, les chenilles naissantes sont bien sûr à
l'avenant !
- Elles sont de surcroît
très remuantes, et du genre "vadrouilleuses", ce qui
favorise censément la recherche d'un point de
pénétration favorable!
-
-





- de gauche à droite: 1
& 2)- 1 mois après la naissance; 3 à
5)- 3 mois après la
naissance.
- Vous noterez que
l'élevage de cette chenille xylophage est aisé ....
sur pomme et pain dur.
- Vous noterez également
que la croissance est nettement moins rapide "in
natura".
-
- Chenille atypique ... mais
mue classique !
-
- Toutes les larves d'insectes croissent
par mues successives, et la chenille de notre Cossus
n'échappe pas à la règle. Vous noterez que
cette règle concerne en fait tous les "Arthropodes", c'est
à dire tous les animaux à pattes articulées,
tels les Crustacés, les Arachnides, les Myriapodes ... et
bien sûr les insectes du cas présent. Toutes les
parties chitinisées muent, y compris les trachées
internes, mais le processus est nettement plus "parlant" au niveau
de la tête, partie fortement chitinisée.
-
- Sur la chenille venant de muer, comme
ci-dessous, la tête est blanche et molle, avec les
mandibules rembrunies, mais non encore fonctionnelles. Il suffira
de quelques jours pour que la chitine se colore, et durcisse, ce
qui permettra à la bestiole de "croquer la pomme" ( du
moins en élevage ! )... en attendant la prochaine mue !
Vous noterez que les chenilles "classiques" ont
généralement 5 mues (parfois 6 pour les futures
femelles), mais j'avoue ignorer si le Cossus est conforme ou
diffère.
-


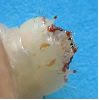

- de gauche à droite:
1)-jchenille de Cossus venant de muer; 2)-
détail de la tête en vue dorsale; 3)-
détail de la tête en vue ventrale; 4)- autre
exemple de mue, cette fois sur très jeune chenille. Vous
noterez que les mues larvaires se font à l'abri de cocons
plus ou moins soyeux et rudimentaires, du moins en regard du
"coconnage" final.
-
-
- Cocons &
chrysalides
-
- A l'approche de la mauvaise saison la
chenille du Cossus se confectionne un cocon à base de soie
et de particules de bois agglomérées. Ce cocon, dit
de diapause, est très comparable au définitif, mais
sensiblement moins dense et épais, d'où une certaine
souplesse. Le cocon définitif est élaboré en
Mai-juin, et il est là aussi à base de bois et de
soie.
-
- La chenille peut le construire là
où elle s'est développée, et donc au sein de
l'arbre nourricier, avec préférence pour les zones
périphériques des parties attaquées. Elle
peut aussi "partir en vadrouille", à la recherche d'un site
à sa convenance, ce qu'elle fait toujours d'un bon pas (ou
plutôt d'une bonne patte ! ), car elle est très
visible, et ses rondeurs ont de quoi satisfaire plus d'un
prédateur.
-
- Le cocon des "vadrouilleuses" est
tissé en de multiples endroits, mais toujours en
intégrant des particules du ou des matériaux
environnants. A titre d'exemple la chenille peut opter pour la
litière superficielle, le dessous d'une pierre, le pied
d'une touffe d'herbe, une anfractuosité du sol,
etc....
-



- de gauche à droite:
1)- cocon de diapause; 2)- détail de la surface;
3)- cocon "définitif" avec sa
chrysalide.
-
-
- .... et en APN
!
-




- exemples de cocons de
Cossus
- de gauche à droite: 1
& 2)- avec chrysalides "in situ": 3)- hors
chrysalide;
- 4)- détail du
revêtement soyeux interne, la partie externe du cocon
étant constituée de copeaux de
bois.
-
-
- La chrysalide est apparemment classique,
mais à l'instar de la Sésie apiforme (cf. page
entomo) la partie dorsale des segments abdominaux est dotée
de rangées de "spicules" (= petites excroissances pointues)
qui favorisent une certaine mobilité de ce type de
chrysalide. Le déplacement se fait par reptation, et au
prix de maintes contorsions, ce qui permet à la chrysalide
en question de gagner le trou de sortie, là où le
papillon ne pourrait le faire, notamment en cas de cocon
élaboré dans les profondeurs du bois. A noter que le
cocon peut être construit sous l'écorce, là
encore comme la Sésie précitée, et
qu'à l'émergence la chrysalide vide reste bien
souvent coincée dans le trou de sortie, et pointe
typiquement à la surface de l'arbre nourricier (comme
ci-dessous, paragraphe "détection").
-


- exemples de chrysalises du
"Gâte-bois"
-



- à gauche:
chrysalide de Cossus en vue latérale; au centre:
idem en vue ventrale; à droite:
détail des spicules.
-
- Détection
-
- En cas d'attaques sévères,
de très typiques agglomérats rougeâtres
peuvent parfois se voir aux pieds des arbres. Constitués de
sciure grossière, d'excréments, et de soie, ils
dégagent une odeur non moins caractéristique de
"vinasse", et plus précisément d'acide pyroligneux,
autrement dit de vinaigre de bois. Sauf à mettre les
narines dessus j'avoue ne pas l'avoir véritablement
constaté, mais en matière de "nez" je suis loin
d'être une référence !
-
-




- de gauche à droite: 1
& 2)- exemples "in natura" d'écoulements de
sciures, consécutifs à l'attaque du
Cossus.
- 3)- écoulement de
sciure, mais en élevage, sur rondin de bouleau. Dans le cas
présent une seule chenille (bonne "bosseuse" ! ) est
à l'oeuvre.
- 4)- illustration des
chrysalides "à mi-corps", mode d'émergence
fréquent chez le Cossus et la Sésie apiforme. Il
s'agit là aussi d'un élevage.
-
- On peut également tomber sur une
chenille "vadrouilleuse", certaines préférant
quitter l'arbre nourricier pour se nymphoser en terre. Il faut
évidemment pas mal de chance, car pour les raisons
précitées la "caterpillar" (comme disent les
anglophones ! ), n'est pas du genre à traîner en
route !
-
- Traitements
-
- Compte tenu de la biologie de cet
insecte, et notamment du fait que la chenille évolue au
sein même de l'arbre, il est très difficile, pour ne
pas dire impossible, d'être efficace, y compris
chimiquement. L'empirique fil de fer souple glissé dans les
galeries a par ailleurs bien peu de chance de trouver une victime.
Les arbres attaqués étant généralement
malades ou vieillissants, il est en fait bien souvent
préférable de les détruire, ce qui limitera
beaucoup les risques de propagation.
-
- Faute de
mieux....
-
- Quand la présence de la
bête est détectée (comme ci-dessus), il est
parfois possible de limiter les dégâts, et en quelque
sorte de reculer l'échéance. Il suffit souvent d'un
peu dégager la base de l'arbre, et le départ des
racines, pour apercevoir des galeries plus ou moins
superficielles...et "garnies". Par delà ce premier constat
(et les premières "éliminations" !), il faut
rechercher les zones où l'écorce "sonne le creux",
et une fois cette dernière enlevée on
débusque souvent bon nombre de chenilles de toutes tailles,
et donc de tous âges.
-
- Les bestioles n' étant pas
habituées à se retrouver à découvert,,
il s'ensuit un effet de surprise évidemment favorable ....
mais mieux vaut trucider ou extirper promptement !. Bien entendu
un traitement insecticide local ne nuit pas, histoire de parfaire
l'ouvrage, mais dites vous bien qu'il en est de ces chenilles
comme des rats: pour une de tuée, dix restent à
l'oeuvre !
-
- En guise de conclusion :
bizarre ... vous avez dit bizarre !
-
- L'élevage des insectes requerrant
un minimum de chaleur et d'humidité, l'éleveur est
souvent confronté au problème des moisissures,
lesquelles peuvent s'avérer d'autant plus
préjudiciables (voire fatales!), qu'elles sont souvent
difficiles à juguler, et plus encore à
éliminer.
-
- Avec le Cossus, qui entre
parenthèses s'élève fort bien sur des pommes,
vous ne verrez jamais la moindre trace de moisi, y compris en
enceinte très confinée. Ce qui n'est pas
consommé pourrit, au point même de devenir quasi
déliquescent, mais rien ne "champignonne", le Cossus
secrétant ce qui pourrait s'apparenter à un
antifongique.
-
- Il m'intéresserait d'ailleurs
d'en mieux connaître le processus, et si un visiteur est au
fait de la question, merci à lui de m'en informer
!
-
-
- Pour info .... la
Zeuzère !
- (Zeuzera
pyrina)
-
- En l'attente d'une possible "page
entomo" spécifique je vous invite à découvrir
un autre Cossidae, à savoir Zeuzera pyrina,
communément appelée la Zeuzère du poirier, ou
encore la "Coquette" eu égard à l'ornementation de
sa livrée et de ses antennes.
-
- L'adulte est nocturne, très
répandu, et il vole de juillet à septembre. Il se
rencontre quasiment partout, y compris dans les parcs et jardins,
et plus encore dans les vergers où la chenille peut causer
de gros dégâts. Elle est en effet xylophage comme
celle du Cossus, et par-delà pommiers et poiriers, ses
préférés, elle s'attaque à plus de 150
espèces d'arbres et d' arbustes, y compris ornementaux.
Autant dire que ce n'est pas un cadeau, et que son
originalité, et sa joliesse, n'enlèvent rien
à sa nuisibilité.
-



- Exemples de Zeuzères du
poirier (Zeuzera pyrina)
- L'image de droite témoigne d'un
gros "coup de bol", car en une seule nuit plus de soixante
Zeuzères ont été "cueillies" à
l'émergence, grâce à mon piège
lumineux. Le pire a donc été évité,
car je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts, si
ces redoutables bestioles n'avaient été
"interceptées" à temps. J'ajouterais que cette
étonnante récolte a fait le bonheur des oiseaux, et
que la mort de mes lilas n'est sans doute pas imputable à
la seule sécheresse.
-
-




- de gauche à droite: 1)-
femelle de Zeuzère "faisant le mort", avec ovipositeur
sorti; 2)- détail de l'ovipositeur ( = oviscapte ),
organe de ponte permettant de très
précisément déposer les oeufs (dans les
anfractuosités de l'écorce par exemple; 3)-
femelle à pondre; 4)- oeufs de Zeuzera pyrina.
Vous noterez qu'il s'agit d'une ponte partielle, la "totale"
pouvant excéder le millier d'oeufs.
-


- chenille de Zeuzère, et
sa chrysalide.
- (clichés dus au talent et
à l'amabilité de Daniel
Cattelain)
-
-

 FIN
FIN-

- les pages entomologiques d'
andré lequet
:
http://www.insectes-net.fr